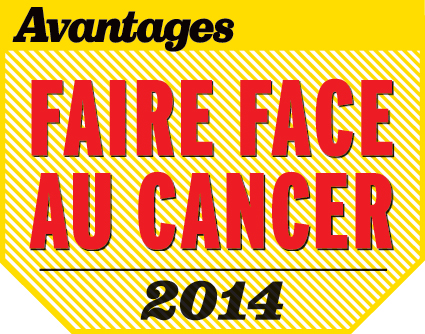
De plus en plus d’employeurs sont confrontés au défi d’aider leurs employés à composer avec le cancer, qu’ils soient des patients, des membres de la famille ou des soignants. Lors du premier colloque « Faire face au cancer », organisé par Avantages le 27 février dernier à Montréal, plusieurs experts ont informé les promoteurs de régimes d’assurance collective sur les continuums de soins. Les derniers traitements contre le cancer, le soutien en milieu de travail, la gestion de l’assurance médicaments et les stratégies de retour au travail étaient parmi les thèmes abordés.
Quelques statistiques
Les plus récentes statistiques sur le cancer montrent que deux Canadiens sur cinq développeront un cancer au cours de leur vie et qu’un Canadien sur quatre en mourra. « Au Québec, en 2013, un cas de cancer est diagnostiqué toutes les 11 minutes et un décès lié au cancer survient toutes les 26 minutes », ajoute Louise Plaisance, une infirmière en oncologie qui travaille depuis un an pour la Ligne Info-cancer de la Fondation québécoise du cancer.
Plus de la moitié des cas nouvellement diagnostiqués seront des cancers du poumon (14 %), des cancers colorectaux (13 %), des cancers de la prostate (14 %) et des cancers du sein (12 %). « Depuis 2005, au Québec, les premières causes de mortalité, devant les maladies cardio-vasculaires, sont les cancers du poumon, colorectal, du sein et du pancréas », ajoute Mme Plaisance. Toutefois, de plus en plus de personnes vivent avec le cancer et vivent plus longtemps. « Quelque 190 000 Québécois ayant reçu un diagnostic de cancer au cours des dix années précédentes sont toujours en vie, dit-elle. C’est une augmentation de 21 % comparativement au nombre déclaré en 1998. »
Les conséquences du cancer sont nombreuses et les séquelles sont à la fois physiques, psychologiques et existentielles. « Entre autres, 46 % des gens se plaignent encore de fatigue jusqu’à 1 an après les traitements, précise Louise Plaisance. C’est, d’ailleurs, la principale plainte que les gens vont nommer dans l’année suivant les traitements. »
Pour l’ensemble des cancers, 63,5 % des patients qui étaient sur le marché du travail y retournent après les traitements, mais 56 % d’entre eux rapportent un changement de rôle ou de carrière. « Le retour au travail est un parcours semé d’embuches. Les difficultés qui se manifestent à ce moment-là peuvent être d’ordre physique, psychologique et organisationnelle. Plusieurs études démontrent que bon nombre de survivants composent avec une diminution de leurs capacités physique et mentale », explique l’infirmière. Pour ces gens ayant vécu un épisode de cancer, le retour au travail équivaut à un retour à la santé et à la vie normale. Un retour au travail réussi passe entre autres, par une bonne préparation incluant un questionnement personnel quant à ses ambitions professionnelles, le soutien de l’employeur et des collègues et la planification d’un retour progressif adapté aux besoins de la personne.
Les enjeux économiques
« Les coûts moyens sur cinq ans, à la suite d’un diagnostic et du traitement d’un cancer, varient entre 85 000 $ et 161 000 $ selon le siège du cancer, indique Pierre Boucher, économiste et directeur général de l’Observatoire des services professionnels. Le nombre croissant de cas va considérablement alourdir la facture. »
En 2010, les maladies chroniques étaient responsables de près de 65 % des coûts du système de santé au Québec, soit 15 795 millions de dollars pour cette année de référence. L’étude « Les coûts économiques du cancer au Québec », réalisée en 2008 pour la Coalition Priorité Cancer au Québec, et qui sera mise à jour en avril, a permis d’établir que les coûts économiques du cancer au Québec sont de 3 480,2 millions de dollars si l’on tient compte des coûts pour le système de santé, mais aussi des coûts liés à la perte de production (72,2 M $), des coûts liés à la baisse du taux d’emploi (258,9 M $), des dépenses supplémentaires des familles (95,8 M $), des coûts supportés par les aidants naturels (177,7 M $) et des coûts liés aux décès prématurés (2 421,3 M $). « Toujours en 2008, le poids des coûts du cancer sur le PIB du Québec est donc de 1,14 %, alors que le poids du budget en santé sur le PIB est de 7,65 %, mentionne l’économiste. Les coûts financiers du cancer dans le budget de la santé correspondent à environ 2 % du coût total. »
Vers des traitements personnalisés
Le Dr Gerald Batist, professeur et directeur du Centre de recherches appliquées au cancer de McGill, travaille sur la mise en place d’un programme qui permet de collaborer, dès le début, avec tous les patients ayant récemment reçu un diagnostic de cancer, afin de recueillir des renseignements sur leurs tumeurs, d’en faire le profil et de les suivre tout au long de leur maladie. « Il faut trouver une façon d’intégrer les forces et de créer une synergie, explique-t-il. L’idée est d’établir un bureau central en lien avec chaque centre hospitalier où se trouvent les patients et où nous faisons de la recherche. » Le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) regroupe actuellement plus de 400 institutions incluant 150 cliniciens et 16 hôpitaux. « Le but est de personnaliser les traitements pour qu’ils soient plus efficaces, ajoute le Dr Batist. Actuellement, 75 % des personnes ne répondent pas aux traitements. Ce n’est pas acceptable. Il faut analyser chaque tumeur afin de proposer des traitements individualisés sur la base de l’analyse biologique de la tumeur et des échantillons normaux apparentés. Cela nécessite le recours à des technologies avancées mais nous les avons au Québec. Cette stratégie va permettre de guérir plus de monde et le coût de la santé en sera diminué. »
Un accès difficile aux traitements
Le cancer du sein, qui est le plus fréquent chez la femme, enregistre des taux de mortalité en baisse constante depuis 30 ans. Toutefois, les traitements qui arrivent sur le marché font face à de nombreuses embûches avant que les patients puissent obtenir un remboursement. « La recherche sur le cancer du sein avance trop vite pour les bureaucrates, constate le Dr Nathaniel Bouganim, oncologue médical au Centre universitaire de santé McGill. Après l’approbation de Santé Canada, il faut attendre des mois, et parfois des années, avant que les médicaments soient approuvés par la province et mis au formulaire. Nous avons des médicaments très efficaces, mais nous n’y avons pas accès. »
Des traitements efficaces
Le Dr Fred Saad, professeur, chef du service d’urologie et directeur du service d’oncologie génito-urinaire du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, rappelle que jusqu’en 2004, il n’existait aucun traitement pour prolonger la vie des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant aux hormones. « Maintenant, nous avons six nouveaux médicaments qui aident à traiter ces patients, se réjouit-il. La façon de traiter le cancer dépend du stade dans lequel on le trouve. On peut avoir une espérance de vie de dix ans malgré la présence de métastases. »
Pour télécharger les présentations de l’événement, veuillez visiter le site web avantages.ca/cancer2014.