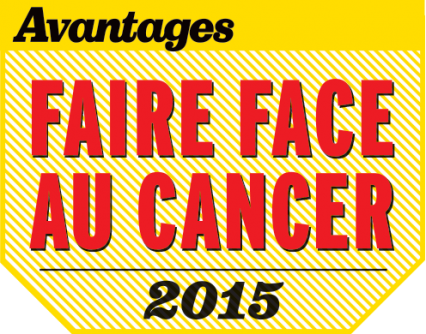
Les employeurs sont de plus en plus confrontés au défi d’aider leurs employés touchés par le cancer. Le deuxième colloque « Faire face au cancer » organisé par Avantages réunissait des promoteurs de régimes et d’autres intervenants du domaine de l’assurance collective, le lundi 23 février dernier à Montréal, afin d’exposer plusieurs enjeux liés au cancer tels que le soutien en milieu de travail, la gestion de l’invalidité et de l’assurance médicaments et l’accès aux meilleurs traitements.
Encadrer le retour au travail
« Toutes les trois minutes, chaque jour, une personne reçoit un diagnostic de cancer », annonçait Patricia Vincent, coordonnatrice au service de soutien psychosocial Cancer J’écoute de la Société canadienne du cancer. Le nombre de nouveaux cas estimés au Canada est passé de 149 000 en 1985 à 191 000 en 2014. « Il est toutefois encourageant de constater que le taux de survie relative à cinq ans chez les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer ne cesse d’augmenter, a ajouté Mme Vincent. Il est passé de 28 % en 1950 à 63 % en 2014 et se dirige de façon évidente vers 68 %. »
Avec le nombre de cas de cancer en augmentation et les taux de survie en constante progression, de nombreux défis sont à prévoir pour les employeurs. La Société canadienne du cancer a analysé comment la survivance était suivie à travers le monde. « Nous avons constaté que lorsqu’il n’y a pas de planification pour la vie de la personne atteinte et pour son retour au travail, certaines décisions et certains choix sont pris rapidement et ne sont pas nécessairement les bons, mentionne Patricia Vincent. Lorsque la personne retourne au travail, il ne suffit pas de l’accueillir. Il faut aussi l’encadrer, ajoute-t-elle. Est-ce que les entreprises ne pourraient pas jumeler chaque personne atteinte avec une autre personne qui sera son soutien ? »
De nombreux outils existent déjà au Canada et à l’international pour aider les personnes atteintes de cancer à reprendre leur vie après un diagnostic. « Il faut travailler en équipe pour référer les employés vers les ressources existantes, croit Patricia Vincent. Ce n’est pas parce que les traitements sont terminés que l’impact de la maladie au niveau physique, psychologique et familial n’est plus présent. L’impact est aussi grand après les traitements, sinon plus. Les gens ont besoin de ressources. Par exemple, les entreprises pourraient mettre en place des normes et des procédures pour mieux réintégrer ces personnes à leur milieu de travail. »
Connaître la maladie et ses impacts
Si plusieurs types de cancers n’ont plus besoin de présentation, d’autres, moins fréquents ou moins connus, font parfois subir aux personnes atteintes un manque de compréhension de la part des employeurs. C’est notamment le cas de la leucémie lymphoïde chronique, l’un d’une cinquantaine de types de lymphome, où un cancer du système immunitaire est diagnostiqué chez 9 000 Canadiens chaque année.
« Ce cancer est méconnu et les gens attendent généralement six mois à deux ans avant de recevoir un diagnostic correct, précise Tracey-Ann Curtis, de Lymphome Canada. La directrice régionale (Québec) de l’organisme a donné l’exemple d’un patient résidant à Sault-Sainte-Marie dont l’employeur a remis en question la véracité du diagnostic reçu. « Faire face à un manque de compréhension et à un manque de compassion au travail, c’est très lourd pour ces gens ! », tranche-t-elle.
Tracey-Ann Curtis a insisté sur la nécessité de mieux aider les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, d’autant plus que de nouvelles thérapies leur offrent de l’espoir. « Ce sont des traitements prometteurs mais il n’est pas facile d’y avoir accès, déplore-t-elle. Étant donné qu’il s’agit de traitements ciblés, ils sont plus coûteux. »
La directrice régionale de Lymphome Canada croit qu’il est nécessaire que les associations de patients, l’industrie, les employeurs, les assureurs et les professionnels de la santé soient des partenaires dans le cheminement du patient. « 80 % des médicaments anticancéreux soumis à l’INESSS [Institut national d’excellence en santé et en services sociaux] depuis juin 2014 ont été refusés, déplore-t-elle. Nous devrions avoir la bonne conscience et l’obligation de combler les lacunes dans les soins de santé. »
Faciliter l’accès aux médicaments
Les problèmes d’accès aux médicaments en oncologie sont très souvent évoqués par les associations de patients et les professionnels de la santé. La recherche ouvre constamment la voie à de nouveaux traitements très prometteurs mais qui ne sont pas toujours accessibles pour les patients. « Le coût des traitements est de plus en plus élevé car la recherche et la mise en marché coûtent plus cher et les molécules sont de plus en plus complexes, explique Olivier Blaizel, pharmacien en milieu hospitalier. Beaucoup de gens n’auraient pas accès à ces médicaments s’ils n’avaient pas une couverture de leurs assurances. »
Ce dernier rappelle toutefois qu’au moment de l’annonce du diagnostic de cancer ou de la récidive, le patient est souvent en état de choc. Dans un tel contexte, il peut avoir du mal à suivre les étapes nécessaires pour obtenir le meilleur remboursement possible. « Ces démarches restent assez complexes, indique M. Blaizel. Il y a des formulaires à remplir, des signatures à obtenir du médecin traitant, des communications avec la compagnie d’assurance et des suivis à faire. »
L’Hôpital Charles-Le Moyne a été le premier centre hospitalier au Québec à mettre en place un coordonnateur à l’accès aux médicaments. « Nous avons commencé en 2009 et plusieurs centres hospitaliers ont emboité le pas depuis, raconte Olivier Blaizel. Le rôle est assumé par quatre ou cinq assistantes techniques en pharmacie (ATP) qui se relaient pour aider le patient. »
Ce programme a rapidement fait ses preuves. « Il permet de diminuer les délais d’accès aux traitements, de réduire le stress du patient et de sa famille ainsi que d’obtenir le meilleur remboursement possible, constate le pharmacien. Cela a un impact direct sur le succès de la thérapie et libère les professionnels de la santé. »
Selon Olivier Blaizel, la présence de coordonnateurs à l’accès aux médicaments est essentielle car les demandes ne cesseront d’augmenter dans les années à venir. « Dans le futur, il y aura de plus en plus de traitements qui coûteront de plus en plus cher, dit-il. Or, il est important de prendre le bon médicament de la bonne façon pour atteindre le succès recherché. »
Le programme mis en place par l’Hôpital Charles-Le Moyne permet aux patients en oncologie d’avoir accès aux traitements qui ne sont pas disponibles à l’hôpital. « Nous nous retrouvons des fois dans une situation où le traitement choisi pour le patient est une option qui n’est pas sur la Liste Établissement de la RAMQ [Régie de l’assurance maladie du Québec], et qui ne peut donc pas être administrée à l’hôpital sauf dans des conditions particulières de nécessité médicale, explique Olivier Blaizel. Nous entamons alors des démarches pour voir si le traitement en question pourrait être couvert par les assurances privées. »
Vers des traitements prometteurs
Urologue-oncologue, professeur titulaire du Département de chirurgie, Division d’urologie à l’Université Laval et chef du Service d’urologie du CHU de Québec, Le Dr Yves Fradet a clôturé le forum en expliquant l’impact des nouveaux traitements sur la survivance des personnes atteintes de cancer de la prostate.
« Au cours des cinq dernières années, quatre ou cinq médicaments ont démontré une amélioration de la survie des patients atteints d’un cancer de la prostate, même à des phases avancées, a-t-il expliqué. Malheureusement, ce sont des médicaments que les compagnies pharmaceutiques proposent à des coûts élevés. Aujourd’hui, avec ces médicaments, les patients vont survivre pendant quatre à cinq ans même lorsqu’ils sont métastatiques, mais ils vont coûter des centaines de milliers de dollars avant de mourir. Il y a donc des questions à se poser. C’est un problème de société. »
L’importance du dépistage
À partir des années 1990, la mortalité par cancer de la prostate a diminué avec l’arrivée du test de dépistage par dosage du PSA. Il s’agit d’un test sanguin qui mesure le risque d’être atteint d’un cancer de la prostate. « Une grande étude européenne a confirmé que l’on peut réduire jusqu’à 40 % le risque relatif de mourir du cancer de la prostate, ajoute le Dr Fradet. Bien sûr, il y a un coût au dépistage et ce dernier n’est pas sans complications. Depuis que nous avons augmenté le nombre de biopsies et leurs fréquences, le nombre d’hommes qui doivent se présenter à l’urgence d’un hôpital parce qu’ils ont eu une complication a augmenté de façon draconienne. »
Certains examens de dépistage, comme la résonance magnétique, permettent de réduire les biopsies mais ne sont pas tous disponibles au Canada. Le test urinaire PCA3, qui figurent parmi les tests offerts au pays, peut réduire de près de 50 % le nombre de biopsies tout en permettant de détecter les cancers agressifs qui sont responsables des décès, affirme le Dr Fradet. « Si nous arrêtons le dépistage, nous allons nous retrouver non seulement avec des cancers métastatiques comme c’était le cas au début de ma pratique il y a 30 ans, mais nous allons aussi en avoir beaucoup plus, précise-t-il. Ce serait alors un désastre en coût et un terrible retour en arrière. »
Les présentations peuvent être téléchargées à partir du site avantages.ca/cancer2015