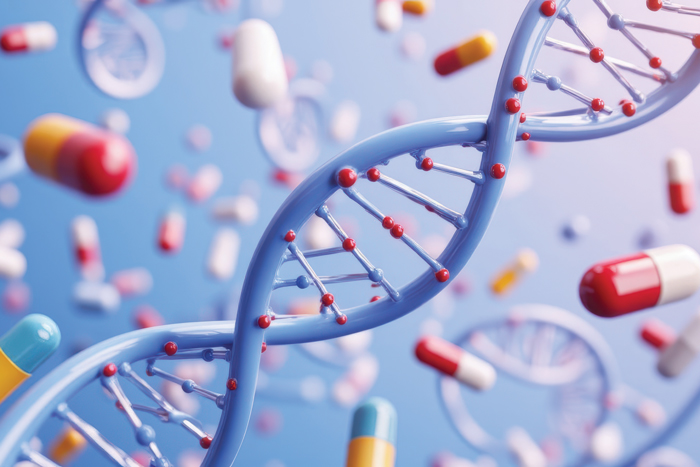
Les résultats probants obtenus dans le cadre de plusieurs projets pilotes ont convaincu les assureurs et les promoteurs de régimes de la pertinence d’inclure la pharmacogénétique dans les programmes d’avantages sociaux. Quels avantages peut-on tirer de cette nouvelle approche ?
La recherche en pharmacogénétique permet désormais une analyse plus approfondie des variations génétiques d’un individu, incluant de plus en plus de gènes pouvant jouer un rôle dans la réponse au traitement. Les tests pharmacogénomiques offrent ainsi des informations plus précises, permettant d’améliorer l’efficacité de certains traitements et de réduire les effets secondaires. Les études et les projets pilotes menés ces dernières années confirment leur efficacité et ont convaincu de plus en plus de cliniciens et d’assureurs d’y avoir recours.
« Un test pharmacogénomique ne permet pas d’évaluer des marqueurs associés à des risques de développer des maladies, précise Michel Cameron, directeur adjoint, pharmacogénomique chez Biron Groupe Santé. Dès lors, ce n’est pas un test pharmacogénomique qui va générer une prise en charge additionnelle avec des examens à suivre. » Les résultats du test vont plutôt fournir au clinicien des informations permettant de cibler une molécule plus efficace qu’une autre pour l’individu et d’ajuster la dose. « L’ADN, c’est le livre de recettes pour construire un corps humain, explique-t-il. Si on regarde la séquence d’ADN des individus, nous sommes presque tous identiques. Mais il y a des variants génétiques, ou marqueurs génétiques, qu’on peut tester. »
Ajuster la dose
Même s’il est accessible à quiconque en fait la demande en ligne et envoie un échantillon de salive par la poste – et assume les frais, car les assurances privées ne remboursent que sous certaines conditions – le test pharmacogénomique comporte des résultats qui doivent être utilisés par le professionnel qui prescrit la médication. « Ces résultats indiquent si la dose établie par les lignes directrices est appropriée ou non pour le patient », explique Michel Cameron.
Pour certains patients, la dose n’est pas appropriée parce qu’ils n’ont pas les métaboliseurs permettant la transformation souhaitée du médicament. « Les individus qu’on appelle des métaboliseurs lents ont besoin de plus de temps pour éliminer une dose de médication, ce qui fait en sorte qu’ils peuvent accumuler de la médication prise chaque jour et se retrouver, au bout de quelques jours, avec une surdose et des effets secondaires », poursuit-il.
À l’inverse, d’autres personnes sont des métaboliseurs rapides. Les concentrations dans le sang n’atteignent jamais des concentrations suffisantes pour avoir un effet thérapeutique. » Le test permet donc au clinicien d’ajuster la dose prescrite au besoin. « Les tests sont de plus en plus précis, car il y a plus de marqueurs et plus de médicaments testés, ajoute Stéphanie Ipavec-Levasseur, directrice de produits chez Desjardins Assurances. La précision du test qu’on reçoit est en constante évolution. »
Qu’est-ce que la pharmacogénétique ?
La pharmacogénétique étudie comment les variations génétiques d’une personne influencent sa réponse aux médicaments. Elle permet de mieux comprendre pourquoi certaines personnes réagissent moins bien que d’autres aux traitements médicamenteux, que ce soit en termes d’efficacité ou d’effets secondaires. Ainsi, la pharmacogénétique permet d’optimiser les prescriptions en tenant compte du profil génétique de l’individu testé, ce qui favorise un traitement plus personnalisé et efficace.
Cibler le médicament le plus efficace
Le test pharmacogénomique permet aussi aux personnes atteintes de maladies d’identifier, parmi les médicaments offerts, celui qui s’avèrera le plus efficace. « Dès lors, on peut éviter beaucoup d’essais et erreurs, se réjouit Éric Trudel, vice-président exécutif et leader, assurance collective à Beneva. Le test permet au médecin de cibler un traitement efficace plus rapidement. Ce faisant, la personne peut revenir en forme au travail plus tôt. »
« Les tests sont de plus en plus précis, car il y a plus de marqueurs et plus de médicaments testés. La précision du test qu’on reçoit est en constante évolution. »
– Stéphanie Ipavec-Levasseur, Desjardins Assurances
« En cas de dépression majeure, il y a 41 % plus de chance de rémission avec la pharmacogénomique. Une simulation faite en Colombie-Britannique indique aussi que si on implantait la pharmacogénomique dans un système de santé publique, on économiserait un milliard de dollars sur 20 ans. »
– Michel Cameron, Biron Groupe Santé
À Beneva, on constate d’ailleurs que la vaste majorité des demandes de remboursement pour ces tests concernent la santé mentale. « En 2024, 96 % d’entre elles étaient liées à des problématiques psychologiques, mentionne Éric Trudel. Mais on commence à voir d’autres problèmes de santé parmi les réclamations au fur et à mesure qu’on a des preuves que cela fonctionne pour d’autres diagnostics. »
Des données probantes
À l’issue de nombreux projets pilotes menés à travers le monde, l’efficacité de la pharmacogénétique est maintenant reconnue. « En cas de dépression majeure, il y a 41 % plus de chance de rémission avec la pharmacogénomique, indique Michel Cameron. Une simulation faite en Colombie-Britannique indique aussi que si on implantait la pharmacogénomique dans un système de santé publique, on économiserait un milliard de dollars sur 20 ans. »
En mai 2024, le Réseau canadien pour le traitement de l’humeur et de l’anxiété a mis à jour ses lignes directrices. « Il recommande de considérer un test pharmacogénétique après une réponse sous-optimale à un premier traitement, mentionne Éric Trudel. Cela montre que la méfiance que suscitaient initialement ces tests dans le milieu médical a évolué ! »
Chez Desjardins Assurances, les tests pharmacogénomiques sont offerts en invalidité, mais aussi avec la garantie accidents et maladies, aux personnes qui ont une raison médicale de faire le test. À Beneva et Sun Life, le test est proposé et remboursé aux personnes en invalidité. « Le coût du test ne nécessite pas beaucoup de journées de travail supplémentaires pour que l’on obtienne une rentabilité, indique Stéphanie Ipavec-Levasseur. On obtient des retombées à la fois quantitatives et qualitatives. Outre le retour au travail plus rapide, on observe une meilleure adhérence aux traitements, car la personne est plus confiante de prendre son médicament. »
« En 2024, 96 % [des tests pharmacogénétiques] étaient liés à des problématiques psychologiques. Mais on commence à voir d’autres problèmes de santé parmi les réclamations au fur et à mesure qu’on a des preuves que cela fonctionne pour d’autres diagnostics. »
– Éric Trudel, Beneva
Une vaste étude financée par l’Union européenne et publiée en février 2023 dans The Lancet a démontré que la réalisation de tests pharmacogénomiques avant le début d’un traitement médicamenteux permet une réduction de 30 % des effets indésirables. Actuellement, les tests pharmacogénomiques sont encore trop souvent utilisés après avoir débuté un traitement, alors qu’ils pourraient s’avérer plus efficaces en prévention.
« On peut facilement voir plusieurs situations où l’on aurait pu éviter un échec de traitement initial si on avait eu l’information au préalable, constate Michel Cameron. C’est un peu comme connaître son groupe sanguin le jour où on doit recevoir une transfusion sanguine. Il y a des endroits dans le monde où on commence à inscrire les résultats de tests pharmacogénomiques dans les dossiers médicaux des patients. »
C’est pour agir plus tôt dans les traitements que Desjardins Assurance a décidé, en 2018, d’inclure le remboursement des tests pharmacogénomiques avec la garantie accidents et maladies. « On a pris la décision très tôt d’offrir une couverture qui n’était pas seulement pour les adhérents en invalidité, mais plus largement en assurances collectives lorsque la personne a une raison médicale de faire le test, explique Stéphanie Ipavec-Levasseur. On trouvait que c’était plus efficace de faire le test plus tôt dans le processus de rétablissement d’un individu, avant qu’il ne soit en invalidité. »
Des réticences demeurent
Même si les réticences des patients sont de moins en moins présentes, à la lumière des études démontrant leur efficacité, les tests pharmacogénomiques suscitent encore des craintes. « Plus on a d’informations, plus on informe les parties prenantes, plus les gens sont rassurés, relève Stéphanie Ipavec-Levasseur. Dans l’information que l’on remet aux participants, on explique les processus et la protection que l’on met sur les données. Cela augmente la confiance et les réticences sont de moins en moins présentes. »
Chez Biron, l’accompagnement d’un pharmacien est offert aux personnes qui passent le test pharmacogénomique ainsi qu’aux médecins. « La consultation est incluse avec le test pour aider le patient à interpréter ses résultats », indique Michel Cameron.

Une étude clinique menée par le fournisseur de tests pharmacogénétiques Pillcheck a conclu que le recours à de tels tests pouvait contribuer à accélérer de
9 à 13
semaines le rétablissement d’un patient souffrant de dépression et/ou d’anxiété.
Les craintes liées à la confidentialité des données sont souvent évoquées et ont forcé la mise en place de mesures de protection très rigoureuses. « C’est de l’information intime, admet Michel Cameron. Il n’y a presque rien de plus personnel que son code génétique ! La confidentialité sera toujours un enjeu. »
Au Canada, la Loi sur la non-discrimination génétique interdit à quiconque d’obliger une personne à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition préalable à la fourniture de biens et services. « Les résultats des tests pharmacogénomiques sont envoyés uniquement au client et au professionnel de la santé que le client désigne », précise Michel Cameron.
« Les sondages que nous avons menés auprès de personnes qui ont réalisé le test ont révélé que 50 % d’entre eux ont eu un changement de traitement à la suite du rapport, c’est donc la preuve que les médecins l’utilisent », ajoute-t-il en spécifiant que le rapport ne justifie pas nécessairement un changement puisqu’il peut révéler que le traitement qui est pris est adéquat.
Actuellement, les tests pharmacogénomiques permettent de tester plus de 40 gènes et de cibler plus de 140 médicaments. « Aujourd’hui, la pharmacogénomique ne va pas prédire à 100 % la réponse à la médication 100 % du temps, indique Michel Cameron. Dans les prochaines années, les scientifiques vont continuer d’identifier de nouveaux marqueurs qui influencent la réponse à la médication. Les tests vont offrir plus de précision. »
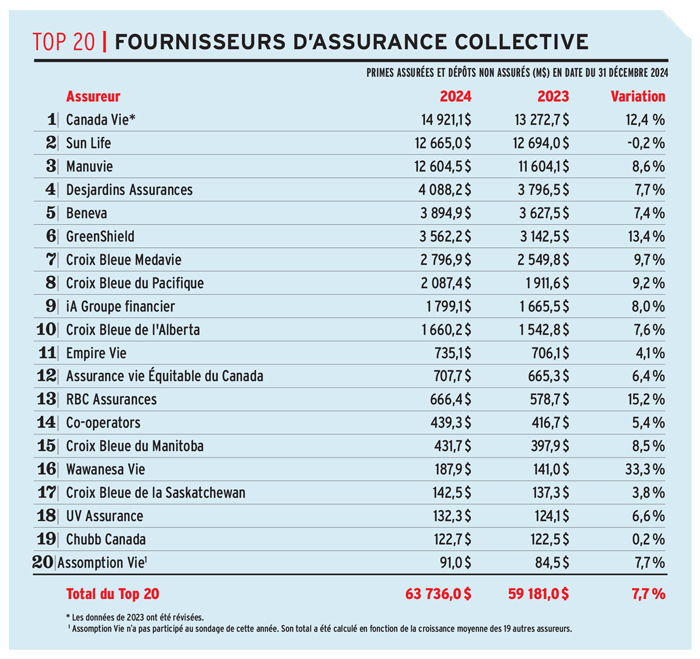
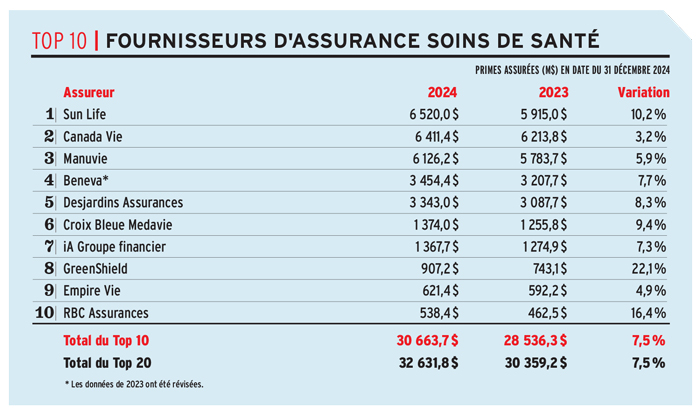
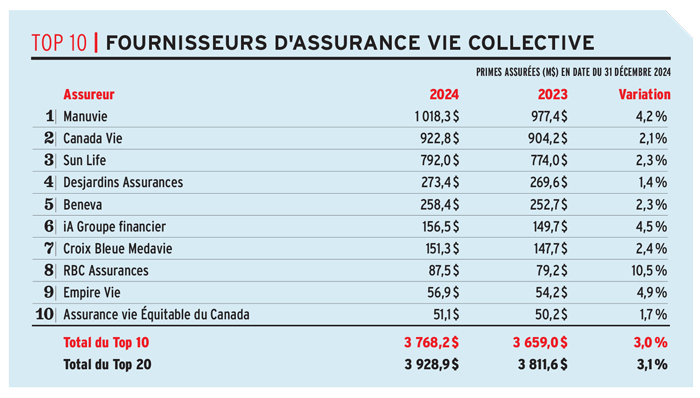
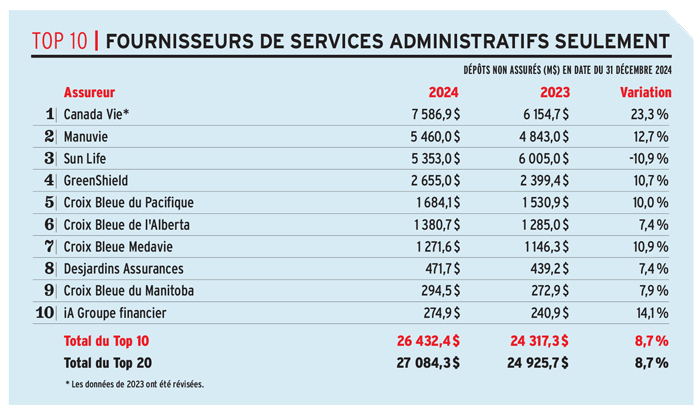
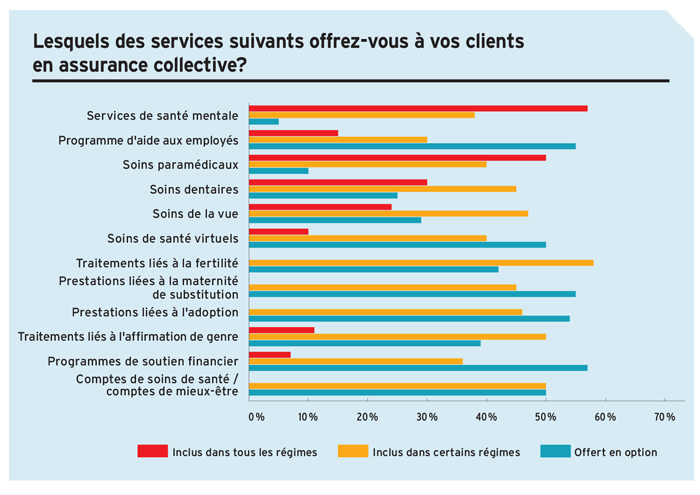
• Ce texte a été publié dans l’édition d’avril-mai 2025 du magazine Avantages.
Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site web.